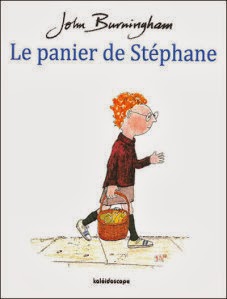"Lili est rentrée de vacances le 15 août, et il s'est mis à pleuvoir. (...) Ma sœur venait à peine de déposer ses bagages dans le salon quand le ciel incolore depuis des semaines s'était brusquement chargé d'encre". Lili a posé ses valises. Lou a posé le décor. En pleine tempête. Lili, c'est Leïla, sœur aînée, en classe de Terminale. Lou, c'est Loubna, la cadette, narratrice, elle entre en seconde, nous sommes au mois d'août. Lili fait son annonce, à table, alors que sa mère lui tend un plat.
" - J'ai commencé le ramadan.
Maman a posé sa fourchette.
ça a fait clic".
La tempête sévit toujours sur les tours de Bobigny. Le vent, la pluie, la nuit. "Lili... Quelle mouche pouvait bien l'avoir piquée cette fois-ci?". Famille décomposée, vie en cité, deux sœurs lycéennes qui semblent si différentes. "Lili, je l'avais su avant de savoir marcher, habitait une planète très éloignée de la mienne".
Lili était déjà partie à plusieurs reprises pour aller vivre quelques mois chez son père. Chez leur père. Et puis elle revenait. Elle s'engueulait tout le temps avec leur mère. Alors Lou mettait son casque, sa musique, se coupait du monde, comme quand elle était petite et que c'étaient ses parents qui s'engueulaient. Peut-être qu'avec ce retour, cette rentrée au lycée les choses allaient changer ?
Lou aime la photo, aime son quartier, les gens, la cité. Elle rencontre Bouba et ses copains graffeurs. Lou fait le mur, peint sur les murs, tombe amoureuse. Pendant ce temps Lili se met à porter le voile, la presse débarque au lycée, peut-elle continuer à le porter dans un établissement public ? Laïcité. Leur mère, infirmière à l'hôpital est débordée, fatiguée, rencontre quelqu'un elle aussi. La communication ne se fait pas dans cette famille au père lointain, absent, et qui se rappelle à elle par un courrier ou un coup de fil, de temps en temps. L'envoi par courrier d'un niqab noir. Lou prend le large, prend ses distances, veut faire ses propres expériences, dans un univers qui n'est pas du tout le même que celui de sa sœur. La nuit. Lili se voile pour mieux se montrer le jour. Coup de projecteur. Télé. Et le bac à la fin de l'année ?
Claire Maugendre signe un roman d'initiation dans lequel la narration est portée par un personnage principal attachant et sensible qui se cherche, construit son identité plus encore qu'en opposition marquée avec sa sœur dont le parcours est lui aussi narré, en écoutant ses émotions et en laissant sa créativité la guider. Une autre forme d'expression. Claire Maugendre à du style, le roman ne laisse pas de marbre sans pour autant être stigmatisant. Finesse et subtilité au cœur de la banlieue sont ainsi en oeuvre dans ce roman, premier roman de Claire Maugendre, un ***coup de coeur*** qui m'a donné envie d'interviewer l'auteure à l'occasion de la sortie.
Drawoua : Lili Babylone est votre premier roman. Un roman de société, un roman dans
la cité. Pourquoi ce choix et cette immersion? Y a t-il un ancrage
autobiographique ? Des idées politiques ? C'est un livre à destination de la
jeunesse adolescente. Quel message porte-t-il ?
 Claire Maugendre : J'étudiais à New York quand la loi sur le "port
ostentatoire de signes religieux" a commencé à être débattue en France
(début 2004). Je sortais d'un mémoire de recherche sur Fellag et les
one-man-show en France, comme lieux résiduels de la culture populaire. Je
m'intéressais depuis longtemps à des questions politiques et d'identité, à ce
qu'on appelle les minorités, à l'histoire de l'immigration et de la
transmission des luttes.
Claire Maugendre : J'étudiais à New York quand la loi sur le "port
ostentatoire de signes religieux" a commencé à être débattue en France
(début 2004). Je sortais d'un mémoire de recherche sur Fellag et les
one-man-show en France, comme lieux résiduels de la culture populaire. Je
m'intéressais depuis longtemps à des questions politiques et d'identité, à ce
qu'on appelle les minorités, à l'histoire de l'immigration et de la
transmission des luttes.
Cette loi qui semblait faire l'unanimité en France (totalement incomprise à
New York) m'a beaucoup questionnée. J'ai grandi dans un environnement familial
imprégné à la fois de laïcité et de profonde croyance (catholique), chacun
étant libre chez moi de vivre sa foi, ou non, comme il l'entend. Il me semblait
que l'école de la république, grâce à laquelle je m'étais construite, prônait
les mêmes valeurs de liberté. Cette loi remettait beaucoup de choses en
question pour moi. Je n'arrivais pas à avoir un avis tranché et j'ai donc
commencé à mener des recherches. Il me semblait que si j'avais été une de ces
jeunes filles, j'aurais rué dans les brancards, comme Lili. J'ai produit donc,
en projet de fin d'étude aux Etats-Unis, un premier travail photographique et
d'installations sur le voile (Janvier 2004 : Je suis française?) qui
posait la question du choix, puis de retour à Paris j'ai écrit une pièce de
théâtre en un acte (2004 Antigone ou Alma et Lila) pour un collectif de
metteurs en scène.
Quand la perspective d'écrire un premier roman pour ado s'est dessinée, je
savais que ce sujet continuait à cristalliser tout un tissu de questions qui me
préoccupaient et qui, je crois, préoccupent la jeunesse dans laquelle je me
reconnais : à quelle histoire, à quel héritage se référer ? Comment grandir en
banlieue quand on est une jeune femme (ce que j'ai été) mais en plus d'origine
algérienne et soupçonné d'être musulmane ? Comment résister à la stigmatisation
des médias, aux absences de perspectives, à la morosité ambiante ? Je suis donc
allée passer du temps à nouveau en banlieue et à Bobigny (où j'avais monté mes
premières pièces de théâtre). J'ai retrouvé chez les adolescents du lycée
Louise Michel ce qui m'avait attirée chez mes meilleures amies du lycée 10 ans
plus tôt : une double, voire une triple culture qui m'ouvrait l'esprit, une
façon de jouer avec les mots et la langue qui me faisaient rire, une
insolence un peu désespérée. Ce premier roman était une façon de leur rendre
hommage et de décrire la France dans laquelle, moi, j'ai envie de vivre.
2/ Famille, adolescence, fratrie, cité, religion, voile, laïcité, lycée,
amour, nuit, graffiti, famille monoparentale, père absent, mère absorbée par
son travail, deux sœurs qui n'ont à première vue pas grand-chose en commun :
est-ce que vous êtes d'accord avec ces éléments mis en avant, quasiment
inextricablement liés ?
Oui, sauf qu'il me semble que Lou et Lili ont plus en commun qu'elles ne
croient. Leïla incarne une révolte, constamment extériorisée, une façon bien à
elle de provoquer et de faire exploser les choses, afin qu'elles restent
toujours en mouvement. Mais Lou, non plus, n'arrive pas vraiment à se
contenter de ce qu'on attend d'elle, du paysage qu'il y a autour, de l'image
qu'on lui renvoie. Elle va apprendre à dire non.
Est-ce une façon de souligner que le paysage de la cité est complexe, ne peut
être saisi, qu'il n'y a pas de schéma qui prédestine ici au port du voile. Vous
auriez presque pu évoquer la délinquance de la même manière, une contre
stigmatisation ?
La littérature, contrairement au documentaire ou au reportage, invite à se
"mettre à la place de", à ressentir "à l'identique de". En
rendant possible l'identification avec un personnage, elle permet de rapprocher
plutôt que de diviser. Evidemment, il n'y a pas de schéma qui prédestine au
port du voile ou à la délinquance mais des histoires singulières, baignées dans
une histoire collective. Or cette histoire collective (celle qu'on nous apprend
à l'école, celle que véhiculent les médias) tend aujourd'hui souvent
à exclure beaucoup plus qu'à intégrer. La littérature est également un merveilleux
territoire pour la réécrire.
3/ La question du port du voile est bien sûr très présente, mais en même
temps, elle n'est pas posée au premier plan, le sujet est traité de manière
plus globale, plus complexe et le voile est d'ailleurs porté par Lili, la sœur
de Lou qui est à la fois la narratrice et le personnage principal. Pourquoi
avoir fait ce choix là ? Cette opposition si frontale entre les sœurs, sans
qu'elle ne soit finalement si radicale ?
Il me semblait d'abord important de ne pas parler "à la place
de". Je ne suis pas musulmane, je n'ai pas fait le choix de porter le
voile. Je peux deviner les motivations qui poussent Lili à se voiler mais je ne
voulais pas confondre son point de vue avec le mien. Il me semblait plus
juste de mettre en place un dispositif biaisé sur cette question, afin de faire
entendre de multiples voix et de laisser le lecteur se faire un avis (comme
Lou, la narratrice). Lou est spectatrice du choix radical de sa sœur et se
retrouve prise en otage de ce qu'il déclenche. Elle n'est pas "pour"
ou "contre" le voile, elle voudrait juste être en paix et qu'on la
laisse tranquille. Mais vu son environnement, c'est difficile... Elle finit
donc par choisir une troisième voie, la sienne: faire sa vie, sortir du cocon
familial, élargir son horizon, créer.
4/ Roman initiatique, référence au mythe de Babylone, tout en étant référence
à la cité associés au prénom de Lili, la sœur aînée, la sœur non idéale,
opposée. Pourquoi ce titre ?
Le titre s'amusait initialement de la similitude de sonorité entre Babylone
et "Balbynien" qui est le nom que portent vraiment les habitants de
Bobigny. Bobigny et la banlieue étant pour moi un personnage à part entière de
ce roman (avec son histoire, ses multiples visages), le litre est apparu très
tôt comme une évidence. Il fait ensuite référence bien sûr au mythe biblique de
la Tour de Babel (la cité maudite) dont les habitants auraient été condamnés à
parler de multiples langues et à ne plus s'entendre. Il me semble, dans la
sonorité même de Babylone, qu'on peut entendre toute la peur de l'étranger et
de la différence.
5/ Une conclusion ?
Il s'agit pour finir en effet d'un roman d'initiation (qui donc ne se
limite pas à la question du voile et des deux sœurs), dont Lou est l'héroïne à
part entière. Lou va vivre son premier amour, prendre son indépendance, en
affrontant les questions qui sont souvent celles de l'adolescence. Comment sortir
de sa solitude, quand tout, autour de soi, paraît chaotique et effrayant?
Comment réussir à entendre sa propre voix et à la faire entendre? Il
me semble que ce sont aussi des questions qu'on se pose toute la vie, à chaque
période en tout cas de mutation.
Lili Babylone de Claire Maugendre,
éditions Ecole des Loisirs, collection Médium, 24 octobre 2013 - 10 €

 Au secours une sorcière au nez crochu, au secours un ogre glouton, deux titres de la même collection pop-up, chez Nathan. Dans chaque titre un personnage affreusement méchant qui fait peur et qui a capturé, là, toute une fratrie qu'il faut retrouver et sauver, dans l'autre une petite souris qui se cache pour ne pas que la sorcière en fasse de la chair à pâté. Beurk et sauve qui peut. Sur chaque page des dizaines des caches derrière lesquels se cachent des choses répugnantes, des scarabées croustillants, des chaussettes sales, des monstres, des araignées chez la sorcière, quand chez l'ogre sont prêts à cuisiner les petits frères et les petites sœurs, servis en tarte aux mioches, en spaghettis... La dernière page s'ouvre sur un monstrueux pop-up représentant l'affreux personnage principal. Horreur ! Malheur ! Vite refermons le livre, pour peut-être recommencer ?
Au secours une sorcière au nez crochu, au secours un ogre glouton, deux titres de la même collection pop-up, chez Nathan. Dans chaque titre un personnage affreusement méchant qui fait peur et qui a capturé, là, toute une fratrie qu'il faut retrouver et sauver, dans l'autre une petite souris qui se cache pour ne pas que la sorcière en fasse de la chair à pâté. Beurk et sauve qui peut. Sur chaque page des dizaines des caches derrière lesquels se cachent des choses répugnantes, des scarabées croustillants, des chaussettes sales, des monstres, des araignées chez la sorcière, quand chez l'ogre sont prêts à cuisiner les petits frères et les petites sœurs, servis en tarte aux mioches, en spaghettis... La dernière page s'ouvre sur un monstrueux pop-up représentant l'affreux personnage principal. Horreur ! Malheur ! Vite refermons le livre, pour peut-être recommencer ?  Trois histoires pour frémir de Jane O'Connor, illustré par Brian Karas. " Ce soir c'est Halloween. Ted attend son ami Danny. Ils doivent aller ensemble à la fête." Quand Danny, arrive, wouaw ! Quel beau déguisement de monstre, il porte ! Grounk ! il dit d'ailleurs. Toute la soirée. C'est même lui qui gagnera le prix du plus beau costume : un énorme paquet de bonbons. Normal qu'il soit malade le lendemain quand Ted le retrouve chez lui. Mais enfin, non, s'étonne la mère de Danny. Il n'était pas à la fête hier. Ah ? Mais qui était le monstre ? Gronk alors ! Une courte histoire bien montée, la première d'une série de trois. la seconde a pour sujet une petite poupée séparée de sa maman poupée par une petite fille capricieuse qui sera bien obligée de plier à ses cris la nuit. Brrr de quoi glacer le sang ! Dans la dernière, mystère mystère et gros chien noir. Lors de son aménagement dans une nouvelle maison la famille Dubois trouve un gros chien noir et un cadre photo. Le chien disparaît mystérieusement par une nuit d'orage pour se retrouver... dans le cadre ! Histoires fantastiques pour titiller les peurs, voilà de quoi est - bien- fait ce petit recueil efficace et facile à lire.
Trois histoires pour frémir de Jane O'Connor, illustré par Brian Karas. " Ce soir c'est Halloween. Ted attend son ami Danny. Ils doivent aller ensemble à la fête." Quand Danny, arrive, wouaw ! Quel beau déguisement de monstre, il porte ! Grounk ! il dit d'ailleurs. Toute la soirée. C'est même lui qui gagnera le prix du plus beau costume : un énorme paquet de bonbons. Normal qu'il soit malade le lendemain quand Ted le retrouve chez lui. Mais enfin, non, s'étonne la mère de Danny. Il n'était pas à la fête hier. Ah ? Mais qui était le monstre ? Gronk alors ! Une courte histoire bien montée, la première d'une série de trois. la seconde a pour sujet une petite poupée séparée de sa maman poupée par une petite fille capricieuse qui sera bien obligée de plier à ses cris la nuit. Brrr de quoi glacer le sang ! Dans la dernière, mystère mystère et gros chien noir. Lors de son aménagement dans une nouvelle maison la famille Dubois trouve un gros chien noir et un cadre photo. Le chien disparaît mystérieusement par une nuit d'orage pour se retrouver... dans le cadre ! Histoires fantastiques pour titiller les peurs, voilà de quoi est - bien- fait ce petit recueil efficace et facile à lire.